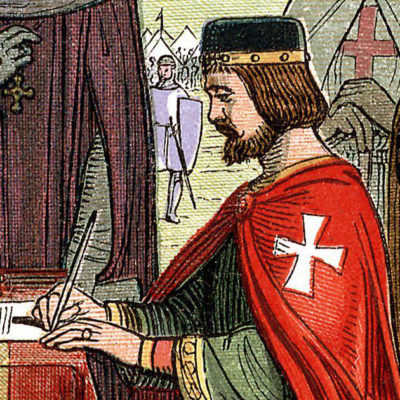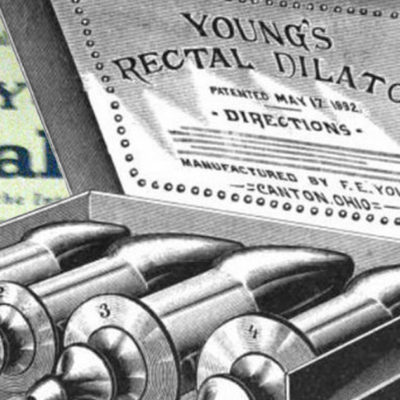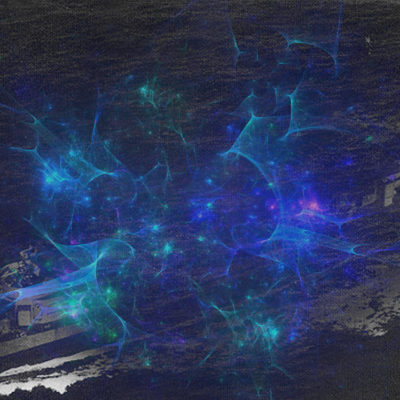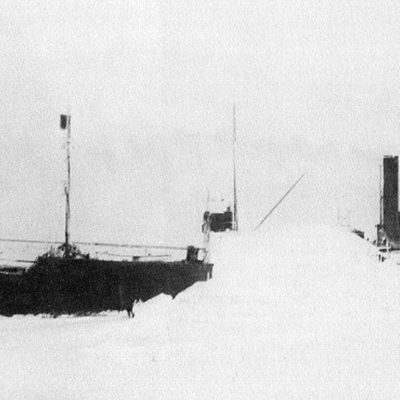Imaginez. Vous êtes victime d’un enlèvement. Il semblerait logique que le ravisseur vous inspire de la peur, de la haine, du mépris. Et pourtant, on constate que les otages ont parfois pour leur ravisseur un sentiment de sympathie… C’est ce que l’on appelle le syndrome de Stockholm.

Stockholm. 23 août 1973. 10h15 du matin. Jan Erik Olsson pousse la porte d’une agence de la Kreditbanken et lance : « Que la fête commence ! » C’est un hold-up. La police est avertie. Elle tente d’intervenir. Olsson tire. Un agent est grièvement blessé et le malfrat décide alors de se retrancher dans l’agence avec les quatre employés. Le hold-up se transforme en une prise d’otages qui va durer six jours.
Olsson, qui vient de s’évader de prison, veut de l’argent, des armes et une voiture. C’est tristement banal. Ce qui est moins banal, par contre, c’est la réaction des otages. Très vite, la presse se fait l’écho de leurs propos. Ils se rangent assez clairement du côté des ravisseurs, Olsson et le complice qui l’a rejoint.
Ils disent craindre moins ces deux hommes que la police. Et lorsque la prise d’otages prend fin, au bout de six jours de négociation, lorsque les bandits sortent de l’agence, les otages se placent volontairement devant eux afin de les protéger.

Par la suite, ils refuseront de témoigner à charge et certains garderont même le contact avec les deux hommes en prison. Un tel comportement ne manque pas d’étonner. Pendant la prise d’otages, un expert psychiatre a d’ailleurs été convoqué, et c’est lui qui utilise pour la première fois l’expression "syndrome de Stockholm".
Six mois plus tard, un autre fait divers défraie la chronique. Cette fois, il se déroule aux États-Unis. En février 1974, Patty Hearst est enlevée sur le site de l’université de Berkeley. Patty Hearst est étudiante, mais c’est surtout la petite-fille de William Randolf Hearst, le magnat de la presse qui inspira à Orson Welles le personnage de Citizen Kane.
Bref, c’est une famille richissime et les ravisseurs, un groupuscule d’extrême-gauche, demandent une énorme rançon sous forme de nourriture à distribuer aux plus démunis.
Sur un air de Starmania
Les tractations s’éternisent. Une année s’écoule. Patty Hearst est toujours aux mains de ses ravisseurs. On ne sait pas exactement comment elle se porte… Jusqu’au jour où, grâce à des caméras de surveillance, on l’aperçoit dans une agence bancaire, en train de commettre un hold-up aux côtés de ses ravisseurs. La petite fille de bonne famille a épousé la cause des extrémistes qui la retiennent prisonnière depuis quatorze mois. L’histoire fait le tour du monde. Elle inspire même à Michel Berger la première trame de Starmania.
L’Amérique est stupéfaite, mais très partagée sur ce qu’il faut en penser. Un psychiatre américain fait alors le parallèle avec le fait divers qui a bouleversé la Suède deux ans auparavant. Il reprend l’idée du syndrome de Stockholm et tente d’expliquer le phénomène.
Cette empathie de l’otage envers son ravisseur serait en fait une réaction de survie. Une réaction de l’inconscient. Quand on éprouve une certaine sympathie pour son agresseur, le danger ne diminue pas, mais la peur du danger diminue. Et quand on refait l’histoire, on se dit que le syndrome de Stockholm a toujours existé. Dans l’Antiquité, lorsque les Romains enlèvent les Sabines et que les Sabines finissent par défendre les Romains, c’est déjà le syndrome de Stockholm.
Plus près de nous, la bienveillance du baron Empain à l’égard de ses ravisseurs ou Natascha Kampusch qui porte le deuil de celui qui l’a séquestrée pendant plus de huit ans, c’est clairement le syndrome de Stockholm. Et l’on estime qu’un mécanisme assez semblable est parfois à l’œuvre dans les cas de maltraitance, de violence conjugale ou encore de dictature. Il n’y a peut-être pas si loin de Stockholm à Pyongyang.